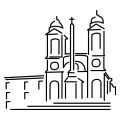Les venerables epoux Carlo Tancerdi e Giulia
Marquis de Barolo
François-Marie Léthel ocd
Le pape François a reconnu les vertus héroïques des deux époux Carlo Tancredi Falletti (1782-1838) et Giulia (Juliette) Colbert (1786-1864), marquis de Barolo. Il les mentionne également dans son important discours du 16 novembre 2023 aux participants à la conférence sur la dimension communautaire de la sainteté, organisée par le Dicastère pour les Causes des Saints, en insistant particulièrement sur la sainteté commune des époux.
La sainteté commune des époux comme « multiplication » de la sainteté personnelle de chacun
En se référant à son Exhortation apostolique C’est la confiance, sur sainte Thérèse de Lisieux, le pape François rappelle comment la sainte contemple l’amour de Jésus qui embrasse toute l’humanité et chaque personne comme si elle était unique au monde. Son témoignage est « le fruit à la fois de la plus haute expérience mystique de l’amour personnel et de la « mystique du nous » (Const. ap. Veritatis gaudium, 4a) » :
« En elle s’interpénètrent les deux modalités de présence du Seigneur, tant dans l’intimité de chaque personne (cf. Jn 14, 23) qu’au milieu de ceux qui sont réunis en son Nom (cf. Mt 18, 20) ; dans le « château de l’âme » et dans le « château de la communauté », pour reprendre une image chère à Thérèse d’Avila (cf. Le château intérieur) ».
Selon les paroles du Pape, ces deux modalités de la présence de Jésus « au plus profond de la personne » et « au milieu de ceux qui sont réunis en son nom » resplendissent de manière éminente dans la sainteté familiale. Nos marquis de Barolo y sont cités avec d’autres couples saints, à la lumière de la Sainte Famille de Nazareth :
« Elle resplendit de manière éminente dans la Sainte Famille de Nazareth (cf. Gaudete et exsultate, 143). Et pourtant, l’Église nous en propose aujourd’hui de nombreux autres exemples : « des couples de saints époux, dans lesquels chacun est un instrument de sanctification pour l’autre » (ibid. 141). Pensons aux saints Louis et Zélie Martin ; aux bienheureux Louis et Maria Beltrame Quattrocchi ; aux vénérables Tancredi et Giulia di Barolo ; aux vénérables Sergio et Domenica Bernardini. La sainteté des époux, outre la sainteté particulière de deux personnes distinctes, est aussi une sainteté commune dans la vie conjugale : donc une multiplication – et non une simple addition – du don personnel de chacun, qui se communique ».
Cette affirmation de la sainteté commune des époux comme « multiplication, et non simple addition du don personnel de chacun » est très importante pour les causes de béatification des époux. Il faut considérer attentivement chacune des deux personnes, car il peut arriver que l’une soit sainte et l’autre non (par exemple sainte Monique et son mari Patrice). Si les deux personnes sont saintes, il faut alors mettre en évidence leur sainteté commune, cette « multiplication ». Mais pour cela, il faut dépasser une conception individualiste de la sainteté, encore assez répandue.
Il me semble important de considérer les deux époux ensemble, avec une seule Positio, comme cela a été fait pour les saints Louis et Zélie Martin, afin de ne pas séparer ceux que Dieu a unis. Au contraire, pour les Barolo, il y a eu deux Positiones séparées, à cinq ans d’intervalle.
Les deux Positiones des Barolo sont excellentes, mais une Positio unique aurait constitué un monument extraordinaire, d’un point de vue théologique, historique et littéraire, pour mettre en évidence, à partir d’une documentation très riche, la beauté de leur sainteté commune.
Le chemin commun vers la sainteté des marquis de Barolo
Carlo Tancredi Falletti, marquis de Barolo, et Juliette Colbert de Maulévrier se sont rencontrés à Paris, à la cour de Napoléon, où ils se sont mariés en 1806. Il avait 24 ans et elle 20 ans. Ces deux jeunes aristocrates étaient très riches à tous les niveaux de la grâce et de la nature, partageant la même vie chrétienne profonde, le même idéal de sainteté. Ils avaient en commun une grande culture religieuse, scientifique, artistique et littéraire. Ils parlaient italien, français, anglais et allemand. Ils ont vécu à l’époque du grand romantisme européen. Sur le plan économique, ils étaient également très riches.
Napoléon lui-même les estimait beaucoup, à tel point qu’il a voulu signer leur contrat de mariage avec son épouse, l’impératrice Joséphine. Pour lui, ce mariage entre deux jeunes gens issus de grandes familles aristocratiques, l’une de Vendée, l’autre du Piémont, avait manifestement une signification politique d’alliance.
Leur mariage fut un véritable mariage d’amour, un amour parfaitement fidèle et toujours plus grand, pendant les 32 années de vie commune, jusqu’à la mort de Tancredi en 1838. Giulia resta veuve pendant 26 ans, jusqu’à sa mort en 1864.
Ces époux si riches étaient en même temps frappés de la plus grande pauvreté pour un couple : ils n’avaient pas d’enfants . Mais ils ont vécu cette pauvreté comme une grâce de plus grande proximité avec les pauvres, envers lesquels ils ont vécu une immense paternité et maternité.
À partir de 1814, après la chute de Napoléon, leur vie se déroule à Turin, dans leur magnifique palais Barolo, près de l’église de la Consolata. C’est une vie toute entière consacrée à la charité, selon leur condition aristocratique, dans l’esprit de saint François de Sales. Ils ne sont pas appelés à renoncer à leurs richesses, mais à les administrer au mieux au service de leur prochain, et surtout des plus pauvres et des plus souffrants.
C’est une charité conjugale, qui réunit deux personnalités très différentes dans une harmonie parfaite, dans le partage continu de tous leurs projets et de toutes leurs œuvres. C’est une charité sociale et politique, culturelle et littéraire.
Leur plus grand ami est Silvio Pellico, qui partage leur vie depuis 1834. Son chef-d’œuvre, Le mie prigioni (Mes prisons), publié en 1832, avait beaucoup impressionné Giulia, qui s’engageait depuis des années au service des femmes détenues à Turin. Il existe de nombreux écrits de Pellico concernant les marquis de Barolo. Il est le témoin privilégié de leur sainteté en tant que couple, de la profondeur de leur amour et en particulier de leur partage quotidien. Entre Giulia et Trancredi, il existe une parfaite unité dans l’égalité, sans la moindre ombre de suspicion ou de jalousie. Il y a une confiance mutuelle totale.
Pellico lui-même rapporte une confidence de Tancredi au sujet de Giulia : « Il m’a dit que même s’il l’aimait beaucoup depuis le début de leur relation, il l’aimait encore plus maintenant ». Dans son testament, Giulia décrit son mari comme « le meilleur des hommes » (T, p. 539-540).
Leur amour mutuel grandit sans cesse car ils sont toujours en contact avec la source qu’est le Cœur de Jésus. Leurs textes spirituels nous révèlent deux cœurs profondément amoureux de Jésus. Tancredi s’exprime ainsi :
« Jésus ! Le promis du Très-Haut, le fidèle, le patient, tu nous as régénérés dans le sang et la douleur de la mort ! Libérateur, Rédempteur, notre Sauveur ! Jésus, seul ami parfait ! Dieu de ma vie ! Amour des amours, cœur divin et source inépuisable de clémence, de pardon, de tendresse généreuse et constante, de bonté sans limites et sans exemple ! Oui ! À partir d’aujourd’hui, je reviens à toi, je ne veux plus m’éloigner de toi un seul instant, m’éloigner avec mon âme et mon cœur de ta pensée, de ton amour béni ! Je veux désormais mettre toute ma gloire à t’appartenir, à t’aimer, à te servir, à me conformer en tout à ta volonté divine ! Ne serait-ce pas le plus grand des crimes que de refuser mon cœur à un Dieu qui m’a tant aimé qu’il a donné sa vie et son sang pour me sauver ? Bien sûr ! Mon âme est le prix du sang et de la vie de Jésus. Je sais combien elle vaut, car je sais ce qu’elle m’a coûté.
Leur engagement caritatif concerne principalement deux formes extrêmes de pauvreté, celle des femmes emprisonnées pour Giulia, et celle des familles les plus pauvres pour Tancredi.
Dans ses Mémoires, Giulia nous révèle son expérience des prisons à partir de 1814 . Tout comme saint François s’était approché des lépreux, la jeune marquise entre dans la prison des hommes et en décrit l’horreur. Puis, la visite du quartier des femmes l’émeut encore plus :
« Leur abjection m’a causé une telle peine, une telle honte, que je ne peux m’en souvenir sans la ressentir encore aujourd’hui. Ces malheureuses et moi étions donc membres d’une même famille, filles du même Père, plantes du même jardin céleste ? Elles aussi avaient connu l’âge de l’innocence ! Elles aussi étaient appelées à l’héritage des élus ! Comment donc… bon Dieu !… Je me souviens avoir serré les mains sur ma poitrine en m’écriant ces mots ». (G, II, p. 14-15).
Immédiatement, à la lumière de sa foi, la marquise se sent sœur de ces pauvres femmes et ressent aussitôt l’appel à se mettre entièrement à leur service. Après avoir surmonté les oppositions initiales de sa famille et de son confesseur, elle reste longtemps enfermée dans la prison, essayant de toucher le cœur et de gagner la confiance des détenues, sans craindre les insultes, les gifles et les crachats. Mais souvent, même avec les plus méchantes, la charité l’emporte. Elle ne se sent jamais supérieure à ces femmes plus blessées, mais les considère toujours comme des sœurs et des amies, travaillant à leur pleine réhabilitation en prison et après leur sortie. Certaines expriment le désir de se consacrer au Seigneur, et pour elles, elle fonde une nouvelle congrégation religieuse : les sœurs pénitentes de sainte Marie-Madeleine, qui sera ensuite approuvée par le pape.
Nous trouvons un très bel exemple de la charité de Gulia envers les femmes emprisonnées :
« Mon cœur m’a servi de maître : j’ai pleuré, j’ai souffert avec elles. J’ai parfois essayé de ne pas prendre de petit-déjeuner avant d’aller à la prison, afin d’avoir plus d’appétit et de montrer ainsi plus de plaisir à partager la soupe avec les détenues. À ces moments-là, elles s’entouraient autour de moi, regardaient avec étonnement l’appétit avec lequel je mangeais leur pain noir, et disaient qu’il leur semblait meilleur ».
Tancredi a été maire de Turin et conseiller d’État, particulièrement attentif à la « classe indigente » des ouvriers pauvres et à la situation dramatique de leurs plus jeunes enfants. Pour eux, il fonda les premières « salles d’asile » dans le palais Barolo, qui était à la fois la maison des pauvres et des plus grands lettrés italiens et européens. Le poète français Lamartine était leur ami et leur hôte.
Le texte le plus expressif de la charité de Tancredi est sa brochure sur l’éducation de la petite enfance de la classe indigente, publiée en 1832 . Il y révèle sa profonde connaissance de la situation dramatique des familles pauvres, de la souffrance de ces enfants et de leurs mères. Il y révèle toute la délicatesse de son amour pour les enfants pauvres, sa grande estime pour les familles pauvres, et en particulier pour les femmes.
Les réflexions contenues dans ces pages correspondent exactement à l’expérience de Tancredi et Giulia, à la profondeur de leur amour paternel et maternel envers ces nombreux enfants pauvres accueillis dans leur maison. C’est une charité éclairée par leur connaissance des bonnes initiatives prises dans d’autres pays, même dans des milieux non catholiques, en Angleterre, en France, en Suisse… Il ne s’agit pas d’une charité privée, mais bien d’une charité politique éclairée par l’Évangile, c’est-à-dire par l’amour de Jésus pour les enfants. Ainsi, la première partie de la brochure commence par la parole de Jésus : « Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits » (Mt 18, 10). Elle décrit ensuite la situation dramatique d’une famille pauvre de Turin, certainement l’une de celles que Tancredi et Giulia ont visitées et aidées. La deuxième partie, qui concerne la réalisation concrète, commence par une autre parole de Jésus dans l’Évangile : « Et quiconque accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c’est moi qu’il accueillera » (Mt 18, 5).
Après l’échec des négociations avec le bienheureux Antonio Rosmini (qui ne s’est pas bien comporté dans cette circonstance), Tancredi entreprend la fondation d’une nouvelle congrégation religieuse, les sœurs de Sainte-Anne, toujours avec l’aide de Giulia. Ainsi, ces laïcs mariés ont fondé ensemble deux nouvelles congrégations religieuses.
Ils étaient amis et bienfaiteurs des saints prêtres turinois : Cottolengo, Cafasso, Bosco et d’autres. Mais même l’anticlérical Cavour est toujours resté leur fidèle ami, qualifiant Tancredi d’« homme le plus charitable du pays » (T, p. 462).
Pendant l’épidémie de choléra qui frappa Turin en 1835, Tancredi, en tant que décurion de la ville, organisa des hôpitaux, des infirmeries et des « bureaux de secours », accueillant même dans son palais quelques jeunes filles rendues orphelines par le choléra. Lorsque les riches et les nobles abandonnèrent Turin, Tancredi et Giulia se dévouèrent avec une grande générosité au service des malades, risquant leur vie pour le bien des autres. À partir de ce moment, la santé de Tancredi devint plus fragile.
Mort de Tancredi et veuvage de Giulia
Frappé d’une violente fièvre, après avoir reçu les derniers sacrements, Tancredi meurt dans les bras de Giulia à Chiari (Brescia), dans un hôtel misérable, le 4 septembre 1838, à l’âge de 56 ans, alors qu’il revenait d’un court voyage.
La mort de son époux bien-aimé est pour Giulia une immense douleur, à la mesure de l’immensité de leur amour, mais toujours transfigurée par la charité, la foi et l’espérance. Il convient ici de citer la lettre écrite par Pellico au frère de Giulia, quatre jours après la mort de Tancredi :
« Qui pourrait dire ce qu’elle a souffert et ce qu’elle souffre encore ? Mais Dieu lui a donné et lui donne une force d’âme extraordinaire. (…) Tous prient pour elle (…) Tous prient aussi pour l’homme excellent que nous avons perdu, mais nous sommes persuadés qu’il est au ciel. La marquise a toutes les raisons de le croire. Il avait une piété de saint. Lors de sa dernière confession, la marquise voulait s’éloigner, mais il ne le voulut pas, disant qu’il n’avait aucun secret pour sa femme » (T, p. 474-475).
Ce détail de la dernière confession de Tancredi est certainement le plus beau témoignage de sa communion totale avec Giulia et de la transparence de son âme.
Après la mort de Tancredi, Giulia elle-même a écrit une lettre sublime à un noble anglais, leur ami. C’est peut-être la plus haute expression de son amour pour son mari, un amour qui continue après la mort et qui s’exprimera dans un nouveau don de soi, encore plus radical, au service des pauvres :
« Récemment, comme vous le savez, le malheur m’a frappée, m’a bouleversée, m’a transformée. Je ne suis plus désormais qu’une naufragée dans la vie, une égarée, qui sait qu’elle doit payer une dette, qui sait qu’elle doit égaliser le score avec les misérables et les parias. Ma richesse est considérable, mais la misère que je vois est telle que je ne sais pas mesurer les extrêmes… Devant moi s’étend une route très difficile ; je dois la parcourir sans me lasser : elle est bordée de mendiants, de misérables, de déchets humains. Je dois vaincre le dégoût et toutes les répugnances.
Savez-vous, milord, comment le dernier des marquis Barolo a terminé sa vie ? La mort l’a surpris par traîtrise sur la route principale et pénible : la route des mendiants ! Il a agonisé dans une auberge misérable : l’auberge des pauvres ! (…).
Croyez-moi, milord, la vie a parfois des avertissements atroces. Enfant, j’ai entendu raconter les événements effrayants de mes ancêtres français, qui ont laissé leur tête sur l’échafaud.
Hier, j’ai vu ma raison de vivre s’effondrer, et dans une heure sombre de silence, devant le mystère auguste de la mort, lors de la veillée funèbre tragique qui m’a permis pour la dernière fois de contempler un visage indiciblement cher, j’ai souffert avec une lucidité effrayante et j’ai senti mon âme se transformer.
Au nom de celui qui a fini comme un mendiant, je dois me consacrer à tous les misérables. Je dois expier les privilèges séculaires de mes ancêtres, je dois payer les dettes qu’ils ont contractées; ; je dois régler le compte implacable que chacun a avec sa propre conscience. Une voix chère et indulgente m’y incite ! Je n’aurai plus d’autre douceur que d’obéir à ce commandement » (G, II, p. 711). »
Héritière universelle de Tancredi, Giulia est très riche, mais en même temps elle est la femme la plus pauvre, tout comme la veuve de l’Évangile. Veuve sans enfants, elle a tout perdu avec la mort de son époux tant aimé, elle a perdu tout le trésor de sa vie, mais cette extrême pauvreté la rendra encore plus proche des pauvres, avec une maternité plus grande. Sa façon de voir dans la mort de Tancredi la même mort que celle des pauvres est magnifique !
Giulia vit son veuvage en communion permanente avec lui au Ciel, avec un nouvel engagement dans la vie intérieure, dans la simplicité et l’austérité, et dans la charité envers les pauvres. Il faut ici citer le testament de Giulia écrit en 1856, 18 ans après la mort de son mari :
« La Providence ayant voulu, dans sa sagesse, contre toute probabilité apparente et malgré les vœux de mon cœur, me faire survivre à mon cher mari, et m’ayant ensuite enlevé mon Père, je dispose de la fortune qui m’a été laissée par ceux que j’aimais et dont la perte m’a été si douloureuse. Je connais parfaitement les pieuses intentions de mon défunt mari, qui me les a si souvent communiquées, concernant l’utilisation de ses biens. Je me souviens du renouvellement qu’il m’en a fait dans ses dispositions testamentaires, et en particulier en me désignant comme son héritière universelle […], comme je l’ai fait de son vivant, et avec l’aide de Dieu, j’exécuterai fidèlement les souhaits qui m’ont été manifestés, et je m’apprête ici à les faire exécuter après sa mort […]. Conformément aux vœux de mon cher époux, j’entends exercer un acte de pleine disponibilité et de maîtrise absolue, n’étant que dans le for intérieur que j’obéis et que je vise à accomplir un devoir moral. C’est pourquoi, demandant l’illumination du Saint-Esprit pour faire en tout la volonté de Dieu et la volonté de celui qui, maintenant au ciel, m’obtiendra, j’ai confiance, la grâce d’achever de fonder et d’établir les choses dans ce monde, de manière à remplir les saintes intentions qu’il avait pendant sa vie, et qui feront maintenant son bonheur éternel » (T. p. 298).
Il est beau de voir comment l’amour de Giulia pour Tancredi ne s’est pas éteint et n’a pas diminué au cours des longues années de veuvage. Au contraire, il est toujours plus vivant et frais, ayant le Ciel pour horizon. Dans le même testament, Giulia crée la nouvelle institution caritative qui devra poursuivre son œuvre après sa mort, « l’Opera Barolo », avec cette expression significative : « Mon âme, en union avec celle de mon époux bien-aimé » (T. p. 298).